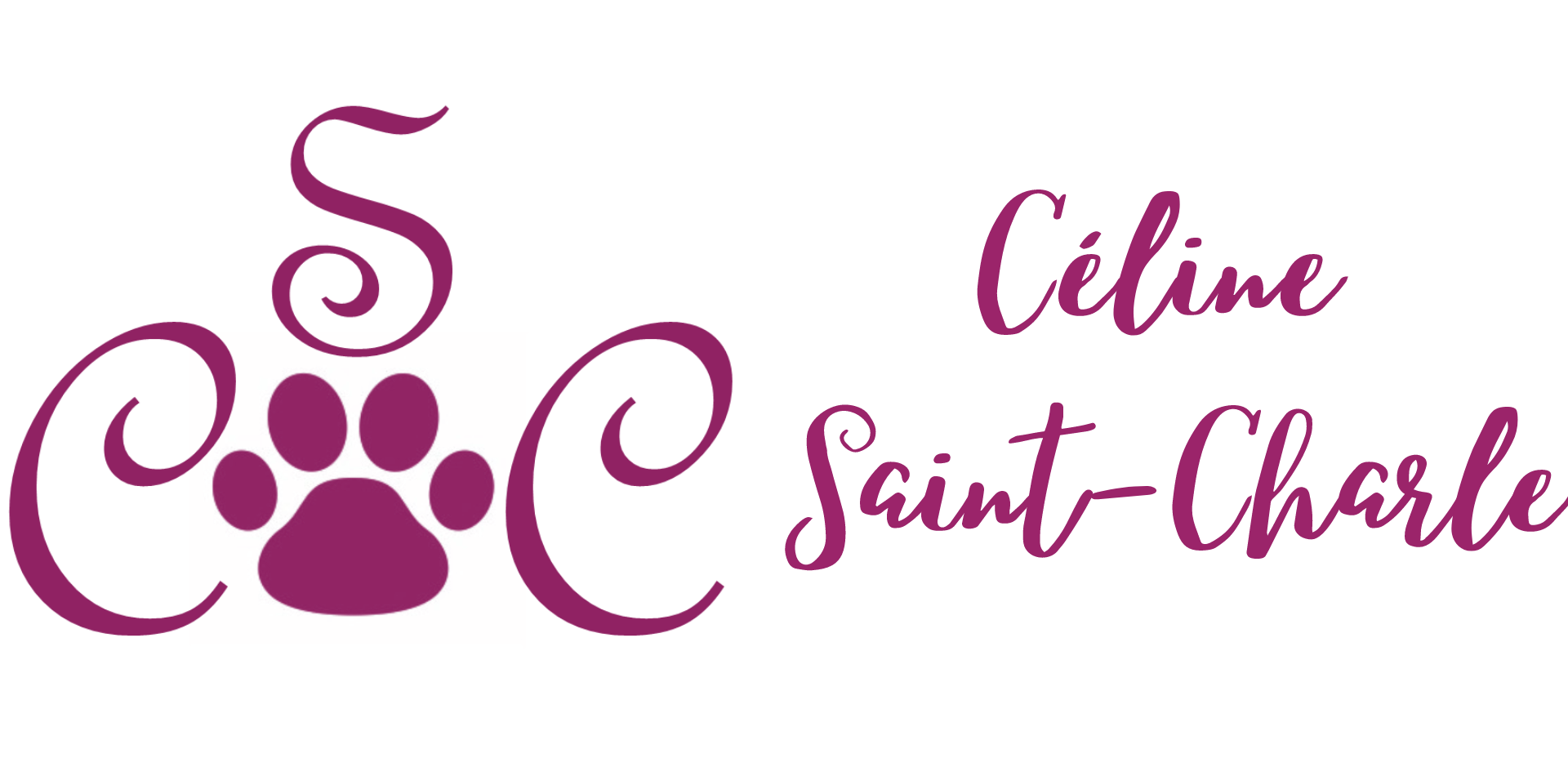Intrigues et poisons au palais Borgia
Céline Saint-Charle
I
In nidis serpentium
1
Lait de beauté à l’amande douce
Amandes pilées, eau de rose, miel clair.
Embellit le teint, adoucit la peau et efface les rougeurs.
Graziella, jupes relevées, perchée sur un rocher plat en haut de la colline, offrait ses mollets nus à la caresse du soleil de ce début septembre. Personne en vue : un rare moment de tranquillité. Elle s’abandonnait aux murmures de ses sens. Que quelque vieille persifleuse la voie ainsi – natte défaite, genoux à l’air, sans corset – et sa réputation déjà bien écornée volerait en éclats.
L’astre descendait sur l’horizon, à son rythme langoureux, après une de ces journées torrides sans un souffle de vent. Derrière la maison, les champs d’oliviers dont la région tirait sa subsistance offraient à la vue leurs fruits mûrs, prêts à être récoltés. Du lointain lui parvenait la clameur obsédante des clochettes des chèvres que le berger conduisait avec patience à la traite du soir. L’air vibrait des mille et un échos de la campagne, charriait les effluves des fermes et des prairies.
Des gouttelettes de sueur taquine prenaient naissance à la racine de ses épais cheveux blonds. Elles la chatouillaient en entamant leur descente le long de ses tempes, frôlant ses joues pour aller se perdre dans le tissu léger de sa robe de lin gris. Certaines s’égaraient en chemin, dans ses sourcils ou sur l’arête de son nez, et elle les essuyait du revers de la main, dans un geste agacé. Dieu avait cette fâcheuse habitude de toujours infliger des contrariétés, y compris dans les moments les plus agréables.
Graziella poussa un long soupir désenchanté. Elle fit tourner une brindille entre ses doigts, le regard perdu dans l’horizon embrasé, cherchant des réponses dans le crépuscule.
Pour la plupart des femmes, cette heure précise du jour supposait l’attente fébrile d’un jeune époux fougueux gravissant la colline au grand galop, pour cueillir un baiser ardent et passionné sur leurs lèvres entrouvertes, leurs enfants maugréant à l’idée d’abandonner leurs jeux pour rentrer à la maison. La soirée allait se dérouler dans la chaleur tendre des foyers emplis d’amour et de rires.
Mais Graziella n’escomptait rien de tout cela. Une fois encore, le père Armando grognerait de déception lorsqu’elle confesserait qu’elle ne désirait point changer son célibat assumé.
— Tu es née pour exécuter les desseins du Seigneur : convoler et enfanter.
Il le lui avait répété mille fois. Elle avait cessé de l’écouter à la centième.
Serafina, sa sœur cadette, s’était mariée un mois plus tôt, et cela n’avait fait que renforcer Graziella dans ses opinions. En Italie, en cet an de grâce 1496, les jeunes filles prenaient époux dès l’âge de quatorze ou quinze ans. Graziella secoua la tête. À dix-neuf ans, elle aurait dû être casée depuis longtemps. La plupart de ses amies du village traînaient déjà une nuée d’enfants, leur future existence tracée par les désirs des hommes. Elle, elle était restée seule avec ce poids : servir son père jusqu’à la fin de ses jours.
Néanmoins, le charme de la jeune fille n’échappait à aucun des habitants de Carvalo[1], riante bourgade au cœur de la campagne de Romagne, à quelques lieues au sud de Rome. Élancée, les courbes voluptueuses, la chevelure couleur de blé mûr – sans doute héritée d’un quelconque Gaulois en maraude –, les iris d’un vert dans lequel on se perdait aisément, elle séduisait tous ceux qui la croisaient.
Fermiers balourds, commerçants patauds, bourgeois imbus d’eux-mêmes, apprentis flatteurs… tous s’étaient frottés à sa langue acerbe et s’y étaient piqués. Aucun homme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, n’avait su trouver grâce à ses yeux.
Jamais elle ne l’avouerait à voix haute, mais, quand cinq ans plus tôt, sa mère lui avait fait jurer sur son lit de mort de toujours s’occuper de son époux et de sa cadette, Graziella avait été soulagée. Une responsabilité aussi lourde et sans débouchés que de prendre le voile, certes, pourtant, elle y trouvait son compte, puisque son père ne cherchait pas à la marier au premier venu, comme c’était l’usage dans tant de familles.
Elle se souvenait encore d’un marché aux bestiaux, des hommes jaugeant les juments en leur soulevant les lèvres, vérifiant leurs dents. Une sensation glaciale lui avait remonté l’échine lorsque, plus tard, elle avait surpris un échange similaire entre deux pères, chuchotant dans l’ombre d’une taverne, les yeux brillants d’appétit.
Naître fille signifiait être traitée avec à peine plus d’égards qu’une vache ou une chèvre. Vendue au plus offrant. Une marchandise tout juste bonne à ouvrir les cuisses, accepter la semence mâle et en expulser le fruit. Après une enfance à traîner dans les fermes des environs, Graziella n’ignorait plus rien des secrets de la reproduction. Pas besoin d’une imagination débordante pour reporter sur les humains ses observations des pratiques animales. Encore quelque chose qui ferait hurler le père Armando !
La jeune fille prenait un malin plaisir à choquer le brave curé, dont les bajoues tremblaient et rougissaient à chacune des frasques qu’elle lui rapportait. Son ample bedaine tendait sa soutane lorsqu’il cherchait à reprendre son souffle, après les sermons moralisateurs qu’il ne manquait jamais de lui infliger.
Pourtant, jamais il ne la dénonçait à son père lorsqu’elle tenait des propos scandaleux. En vérité, il avait pitié d’elle, cette gamine sans mère livrée à elle-même et chargée d’un fardeau bien trop lourd pour elle.
*
De retour dans la grande salle familiale, Graziella contempla les portraits de ses ancêtres sur les murs. Ces hommes et femmes à l’air revêche la dévisageaient avec sévérité. Comment son père avait-il pu laisser tout cela s’effondrer ? Il se révélait incapable de gérer le domaine, au contraire de son grand-père autrefois, maître incontesté des biens et des affaires. Graziella adorait son père, un homme gai et affable. Sa famille paternelle, des propriétaires terriens aisés, n’avait eu de cesse au fil du temps de s’élever dans la société, en acquérant à tour de bras tous les terrains disponibles.
Ils cultivaient le sol fertile de Romagne, faisant pousser céréales, vignes et oliviers, afin d’alimenter Rome toute proche. Rome, vorace et jamais rassasiée, achetait, achetait, achetait… enrichissant les bourgeois ruraux et assurant la subsistance de milliers de métayers et de journaliers.
Le grand-père de Graziella, un homme rusé et ambitieux, avait sacrifié un peu de ses terres arables pour construire des bâtiments où entreposer le grain, transformer le raisin en vin et les olives en huile. Contrôlant ainsi la totalité du processus de production, il pouvait de surcroît spéculer sur le cours des denrées et, les années de disette, engranger de véritables fortunes.
Le père de la jeune fille n’avait manqué de rien : précepteurs, maîtres de musique, professeurs de dessin… Il avait reçu une éducation digne des meilleures familles. Un pari qui pouvait sembler malin, mais qui pourtant risquait aujourd’hui de causer la perte de toute l’exploitation. Le père de Graziella se piquait de posséder une âme d’artiste et clamait à qui voulait bien l’écouter – en général des ivrognes ravis de délester sa bourse des deniers qu’elle contenait – qu’il pouvait rivaliser avec les plus célèbres peintres. Les pinceaux abandonnés roulaient sur la table, trempant dans une flaque d’ocre. Une nappe tachée de vin, un reste de pain grignoté, et lui, riant aux éclats sous la tonnelle, un bras enroulé autour des épaules d’un compagnon d’ivresse, promettant encore une fois qu’il commencerait son chef-d’œuvre… demain.
Les aspirations du grand-père ne connaissaient aucune limite : il avait apporté un vernis supplémentaire de respectabilité à son nom, en mariant son fils unique à une jeune noble issue d’une famille appauvrie. Une alliance sans passion, pourtant réussie, car empreinte d’une profonde estime mutuelle et d’une affection sans faille. Bien sûr, à la mort de la mère de Graziella, le titre et les avantages afférents étaient aussitôt devenus caducs. Si au moins l’union avait produit un héritier mâle, une dérogation aurait pu être demandée au prince. Mais avec « seulement » deux filles…
Le grand-père s’était éteint après une mauvaise chute de cheval, quand Graziella venait de fêter ses huit ans. Son père avait tout essayé pour reprendre le flambeau, avec un succès très mitigé. Incapable de se concentrer sur les colonnes de chiffres des comptes, sans aucun sens des affaires, préférant rêvasser sur la terrasse, un gobelet de bon vin entre les doigts, il oubliait les rendez-vous, laissait passer les échéances et accumulait les dettes. De guerre lasse, il avait fini par remettre les rênes du domaine à un intendant roublard, adepte d’une formule simple : un ducat pour la famille Maraval, deux ducats pour sa propre poche.
Graziella bouillait en constatant presque chaque jour les exactions commises par le maraud. Par exemple, les réserves inscrites dans les livres ne correspondaient jamais à ce qu’elle voyait de ses propres yeux dans les entrepôts. Quand elle tentait d’alerter son père, celui-ci balayait ses mises en garde d’un geste indifférent.
— Allons, ma chérie, n’encombre pas ta jolie tête de ce genre de choses. Ces sujets ne concernent pas les femmes. Va donc feuilleter un peu de poésie ou confectionner un beau bouquet pour la table de la merenda[2].
Pourtant, elle aussi avait bénéficié de la meilleure éducation accessible à son statut social. Outre les traditionnels enseignements, lecture, écriture, broderie, musique, danse, latin et philosophie, Graziella possédait de solides notions de mathématiques, d’astronomie, de rhétorique, d’histoire et de théologie. Toutes matières d’ordinaire plutôt réservées aux garçons.
Elle rongeait son frein, impuissante, rêvant d’un monde où elle serait autorisée à prendre la tête de l’entreprise familiale et à renvoyer l’intendant avec perte et fracas. Hélas, elle n’avait d’autre solution que de le surveiller de près et de réparer aussi discrètement que possible ses « erreurs » comptables.
*
De retour dans la maison, Graziella coula un regard songeur par la porte entrouverte et posa lentement le couteau avec lequel elle hachait des herbes pour une pommade cicatrisante. Toujours avec circonspection, y compris en l’absence de quiconque susceptible de l’arrêter ou de la questionner, elle se glissa dans le jardin et grimpa jusqu’à l’oliveraie.
Son arbre préféré, au tronc noueux et tourmenté, lui offrit l’asile de ses branches déployées, à l’abri des regards, laissant passer juste ce qu’il fallait de la douce chaleur de la fin du jour. Perdue dans la contemplation du soleil couchant, turquoise et nacres mêlés de pourpre, Graziella donna libre cours à ses émotions, persuadée que cela s’apparentait à un péché. Mais en était-ce vraiment un, ce sentiment irrésistible qui l’assaillait parfois ?
Quelle serait sa destinée ? Comment se manifesterait-elle dans un si petit village ? Elle n’en avait aucune idée. S’agirait-il d’un grand amour ? D’un grand désastre ? D’une occasion inespérée ? Elle eût été bien en peine de le prédire. Son unique certitude : elle finirait par quitter Carvalo, et le cours de sa vie s’en trouverait bouleversé. D’où lui venait cette conviction ? Elle l’ignorait et n’en avait cure.
Jamais elle ne s’était sentie assez courageuse pour le confesser au père Armando ni pour lui avouer l’origine de ses humeurs chagrines. Il lui aurait probablement enjoint de chasser toutes ces mauvaises pensées de son esprit, la mettant en garde contre les œuvres de Satan, destinées à corrompre son âme pure de bonne chrétienne. Pourtant, sans cette obscure espérance enfouie dans les tréfonds de son être, elle ne pourrait supporter sa vie.
2
Eau de verveine pour les songes troubles
Infusion légère de verveine citronnée, prise à la tombée du jour.
Éloigne les cauchemars, favorise les rêves vrais.
— Graziella ?
Serafina ! Elles avaient toujours joui d’une grande proximité, trouvant refuge l’une auprès de l’autre après la mort de leur mère. Graziella avait élevé sa puînée.
Avant le mariage de Serafina avec Salvatore, un séduisant fermier, le vieil arbre à secrets avait souvent ouvert ses branches avec bienveillance, pour des moments d’intimité. Graziella se leva avec précipitation, tendit les deux mains à sa cadette en signe de bienvenue.
— Oh, Serafina, comme c’est bon de te revoir ! Je me sentais si seule.
Elles s’embrassèrent avec effusion. Les yeux sombres de sa sœur brillaient, tout son corps rayonnait d’une sensualité sereine et mutine que son aînée ne lui connaissait pas auparavant. Serafina l’enlaça, et Graziella huma la chaleur du soleil encore emprisonnée dans sa peau. L’odeur du blé et du lait frais s’accrochait à ses cheveux noirs. Un éclat de rire fusa, vibrant comme un grelot.
Est-ce donc cela que produit l’amour ?
Serafina se coula à son tour contre le tronc moussu, sa jupe tournoyant autour d’elle, dans un mouvement de coquetterie inconsciente, une moue charmante sur les lèvres.
Elle sait d’instinct comment éveiller les désirs d’un homme, songea Graziella, souriant intérieurement.
Aussi brune et mate que sa sœur était blonde et avait la peau pâle, clairsemée de taches de rousseur, Serafina correspondait en tous points à la beauté italienne classique.
— J’ai presque honte de mon bonheur… Je m’inquiète tellement à ton sujet. Salvatore pense, comme moi, que tu ne peux continuer de gâcher ta vie ici, à sacrifier ta jeunesse pour Père. Il passe plus de temps dans les tavernes qu’à la maison, à la poursuite d’illusions impossibles. Avec ton charme exotique, tu ferais chavirer Rome ! Tu pourrais devenir duchessa[3] ou même principessa[4] !
— Rome ! s’écria Graziella en riant. Tu rêves, Serafina ! Autant m’imaginer volant dans une des absurdes machines de messire Leonardo da Vinci. Si tu avais entendu cela, Serafina… Ce peintre itinérant s’est entretenu durant une heure ou deux avec Père, hier soir. On a beau le gratifier du titre de « plus important artiste de notre époque », il commence à passer pour un fou, avec ses prétentions de faire planer les hommes dans le ciel à l’instar des oiseaux. Peut-on se figurer une telle absurdité ?
— Certes non, convint sa jeune sœur.
Elle se pencha en avant, et sa voix devint un murmure tout juste audible par-dessus la stridulation des grillons.
— Nous aussi, nous avons reçu un visiteur, hier. Un messager du grand Cesare Borgia, le cardinal de Valence. Il a fait halte dans notre ferme pour se rassasier de notre pain et de l’onctuosité du lait de nos chèvres, avant d’entamer les douze lieues[5] le séparant encore de sa destination. Nous l’avons bien accueilli, comme tu peux t’en douter. S’il pouvait glisser un mot bienveillant sur nos produits à l’oreille des cuisiniers du palais, notre fortune serait faite. Oh, Graziella, les intrigues qu’il a pu nous narrer !
Les yeux d’ébène brillaient désormais d’excitation.
— Bien que leur père, notre bien-aimé pape Alexandre VI, soit le véritable souverain de Rome et naturellement de la chrétienté dans son entièreté, la ville semble dominée par Cesare – le Magnifique, ainsi qu’ils le surnomment – et sa ravissante sœur Lucrezia. Ils collectionnent la perfection comme nous autrefois les coquilles d’escargots ou les cailloux étincelants. Les joyaux les plus rares et les plus finement ciselés affluent à leur cour. Mais selon l’illustre messager, la beauté humaine, seule, n’a pas de prix pour eux. Les athlètes les plus admirables, les pages les plus séduisants et des jeunes femmes à faire pâlir d’envie Hélène de Troie en personne se disputent leurs faveurs.
Graziella haussait les sourcils en écoutant Serafina. La beauté que le cardinal de Valence chérissait… Elle en était flattée, mais une part d’elle se rebellait.
Alors c’est ça, leur idéal ? Des corps à aligner, à posséder et à exhiber comme des vases rares ?
Serafina marqua une pause pour reprendre son souffle, rendu court par l’enthousiasme. Puis elle s’empressa d’ajouter :
— Tu ne déparerais pas dans leur sélection, Graziella. Tu la rehausserais, au contraire.
Graziella attira sa cadette contre elle dans un geste de gratitude, également destiné à masquer l’étrange lueur de révolte qu’elle sentait danser dans ses pupilles.
— Je ne suis pas une figurine de vitrine, commenta-t-elle sèchement. Ma place est ici, je ne peux pas rompre le serment fait à notre mère, ce serait un sacrilège ! De toute façon, je ne possède pas de quoi m’offrir ne serait-ce qu’un âne rabougri pour parcourir une telle distance.
Sentant Serafina, étonnée de son ton, se raidir contre elle, elle laissa son sens de l’humour habituel reprendre le dessus.
— Tu imagines tes fameux Borgia prêter attention à une fille sans le sou, vêtue de vieilles nippes fatiguées et puant le crottin ? Au milieu d’une foule de mendiants geignards ?
Serafina se leva d’un bond. Salvatore n’allait plus tarder à rentrer des champs, et l’attitude de sa sœur la contrariait.
— Tu exagères toujours ! Sans le sou ? Bah, à d’autres ! Tu pourrais partir demain, si tu le voulais. Notre père se débrouillerait bien ! Je laisse la soupe du soir sans surveillance sur le feu pour te porter ces nouvelles, et c’est tout l’effet que ça te fait ? Mais le monde est à tes pieds, il te suffit de te pencher pour le ramasser. Qu’attends-tu ?
Serafina s’enfuit en sautillant. Graziella se mordit les lèvres, troublée par toutes les paroles qu’elle ravalait. Comment expliquer la situation à sa cadette, dans toute son odieuse réalité ? Comment ?
*
La veille, après que leur hôte se fut couché, la jeune fille avait profité d’une des rares soirées de sobriété de son père. Maestro Leonardo était connu pour prôner une alimentation simple et équilibrée, sans excès, notamment de boisson. Aussi, pour que le célèbre inventeur ne se forge pas une piètre opinion de lui, son père s’était-il senti obligé de modérer sa consommation.
— Padre, les journaliers grognent. Ils n’ont pas reçu leur stipendio[6] pour les moissons d’août. Beaucoup menacent d’aller chercher un emploi ailleurs. Comment ferons-nous à partir du mois prochain, quand commencera la récolte des olives, si tous nous font faux bond ?
Messere[7] Maraval lui avait caressé la joue en tirant sur sa pipe odorante.
— Dieu y pourvoira bien…
— Mais…
— Pas de mais qui tienne, mon enfant. Ce colporteur passé à Carvalo il y a quelques semaines proposait des pigments bien trop magnifiques pour que je le laisse repartir ! Je pressens qu’avec son bleu, je vais créer des tableaux inoubliables. Leonardo lui-même m’a confirmé que la qualité des matières influait sur le rendu final…
Graziella serrait les poings en luttant contre les larmes. Encore un achat qu’elle ignorait et qui venait s’ajouter à la longue liste des folies de son père. Il ne jurait que par les pigments et les matériaux les plus onéreux, dépensant sans compter. À force de l’entendre discourir avec les artistes de passage – qui vidaient cave à vin et garde-manger –, la jeune fille connaissait sur le bout des ongles tout ce qui meublait le quotidien d’un peintre.
Le bleu outremer qu’il évoquait figurait tout en haut du palmarès. Obtenu à partir de lapis-lazuli broyé à la main, importé à grands frais du lointain Orient, il pouvait coûter jusqu’à trois florins le gramme. De quoi rémunérer toute une semaine de travail d’un ouvrier agricole !
— Combien lui en avez-vous acheté ?
La question avait fusé, abrupte, et sans aucune des formes de respect filial qu’il était en droit d’attendre de Graziella. Heureusement, son père, ravi de parler de sa passion, n’y prêta pas attention.
— Oh, rien que deux petits grammes. Voilà tout ce qu’il avait à me proposer.
La jeune fille envoya des grâces silencieuses au Tout-Puissant.
— En revanche, j’ai pu lui soutirer deux onces[8] de vermillon pour vingt-deux florins. Une bonne affaire !
Sa mine réjouie arracha un gémissement à Graziella. Encore des semaines de labeur humain parties sur la palette de son père. Pourquoi ne pouvait-il se contenter des ocres venus de la Toscane toute proche ou du noir de charbon ? Remplacer le bleu outremer et le vermillon par l’azurite et la laque de garance, moins coûteuses ?
De la même façon, il ne jurait que par les pinceaux en poils de martre, dédaignant ceux en soies de porc, jugés trop rustiques. Et, à l’instar de maestro Leonardo, il ne peignait que sur bois, peuplier ou noyer. La toile de lin ne trouvait grâce à ses yeux que pour ce qu’il nommait ses « barbouillages d’entraînement ».
Graziella l’aimait trop pour lui assener tout de go ce qu’elle pensait de son talent. Ou plutôt de son absence totale de talent. Cela le tuerait, à coup sûr. Pourtant, combien de temps encore l’exploitation survivrait-elle à ses habitudes dispendieuses ?
*
Pas un souffle de vent ne froissait les feuilles. Le temps tournait peu à peu à l’orage. La chaleur émanant des braises dans l’âtre semblait intolérable à Graziella, qui grillait des poissons fraîchement pêchés par un métayer dans la rivière locale. Elle avait le visage en feu et des filets de sueur perlaient sous son épaisse chevelure hâtivement nouée sur la nuque. Il restait au moins une heure avant le retour de son père, sinon plus. Il ne prêterait sans doute pas plus d’attention à ses états d’âme que les autres jours, absorbé dans une nouvelle idée destinée à asseoir leur fortune. Une de plus, vouée à l’échec comme les précédentes.
En plus de se piquer de peinture, il était persuadé d’être un fin connaisseur de l’économie et des affaires. Il s’engageait avec tous les rêveurs, tous ceux qui nécessitaient des fonds pour commencer une activité quelconque. Mais également avec tous les truffatori[9] de la région, alléchés par l’argent facile, et qui n’avaient aucun mal à le convaincre de vider sa bourse, avant de disparaître pour toujours, un sourire satisfait aux lèvres. De toute façon, escrocs ou pas, cela ne changeait rien au bout du compte, puisqu’il finissait en général par déclarer, penaud :
— Ah, j’ai joué de malchance. Cela ira mieux la prochaine fois.
Après avoir mis de côté le récipient grésillant, la jeune fille grimpa jusqu’à sa chambre. Une atmosphère plus étouffante encore l’y accueillit. La chaleur du soleil s’était accumulée par le toit durant le jour, et la minuscule ouverture ne laissait pas entrer la moindre brise. L’odeur prégnante de térébenthine, mêlée étroitement à celle de l’huile de lin, émanant de l’atelier de son père, situé de l’autre côté du couloir, la fit presque suffoquer.
— La peste soit des peintres ! grommela-t-elle. J’aurais préféré qu’il se consacre à la poésie. Au moins, le papier et l’encre sont meilleur marché et ne sentent pas aussi mauvais. Encore que la lubie d’un recueil de poèmes enluminé à la feuille d’or aurait pu le prendre !
Tout en gloussant de son bon mot, Graziella dénoua sa ceinture d’argent en un tournemain – une ravissante chaîne de colombes entrelacées, héritée de sa mère – et laissa sa robe grise humide de sueur glisser sur le plancher. Les cheveux prestement relevés en un chignon gracieux, et enserrés dans une fine résille semée de perles, elle enfila une chemise de toile blanche qui lui dégageait gorge et épaules. Au diable ses sandales à lanières de cuir ! Elle livra avec délice la plante de ses pieds à la fraîcheur relative du carrelage ocre, dévala les escaliers et sortit dans le jardin.
Elle respirait toujours mieux dehors que dans la maison à l’atmosphère lourde des soucis du quotidien.
Une vigne épaisse accrochée à un treillis recouvrait la petite cour où la table était dressée pour la cena[10]. Celle-ci consistait en un simple plateau d’olivier, patiné par des années de service et de soin, reposant sur des tréteaux. Une jatte de bois croulait sous les fruits : oranges, raisins, olives, citrons doux. Une autre contenait toutes sortes de légumes marinés dans l’huile et parsemés de graines de coriandre. Deux gobelets de métal poli flanquaient une outre de vin gorgé de soleil et un pichet d’eau fraîche du puits. Le poisson serait bientôt cuit. En attendant, Graziella s’abandonna voluptueusement au lit d’herbe tendre qui l’attirait.
L’orage qui avait éclaté quelques minutes auparavant s’éloignait. De rares éclairs crépitaient encore sur les collines du côté de Rome. Les nuages lourds avaient cédé la place à une obscurité soudaine qui lui parut de mauvais augure. La lune se cachait quelque part, et le tapis d’étoiles qu’elle contemplait d’ordinaire se refusait ce soir. Seule la lanterne posée sur la table, à quelques pas de là, procurait un peu de lumière, comme un phare dans la tempête. Une nuée vrombissante de papillons de nuit se pressait devant la flamme fragile. Graziella frissonna. L’air chargé d’électricité lui avait mis les nerfs à fleur de peau.
Elle se releva, l’oreille aux aguets. Pourquoi ? Elle n’aurait su l’expliquer. Rien d’autre ne troublait le silence que les cymbalisations des cigales dans les hautes herbes environnantes.
[1] Ville fictive.
[2] Collation légère de l’après-midi, généralement entre 15 h et 17 h.
[3] Duchesse.
[4] Princesse.
[5] Environ dix-huit kilomètres.
[6] Salaire des journaliers agricoles.
[7] Monsieur ou messire.
[8] Un peu plus de 28 grammes dans une once.
[9] Escrocs.
[10] Dîner, généralement pris entre 18 h et 21 h.