Ce premier chapitre vous donne envie de découvrir le personnage et son histoire ? Vous trouverez facilement ce roman en format papier et numérique dans la boutique. Bien entendu, vous pouvez aussi vous rendre directement chez votre libraire et lui commander.
Chapitre 1
Aujourd’hui.
Comme chaque fois, j’ai longuement attendu le bus devant la fac. Lorsqu’il est enfin arrivé, j’étais trempée. L’arrêt consiste en un simple poteau de béton fatigué, dont le crépi s’écaille. Rien ne permet de s’abriter. Une pluie fine tombe depuis ce matin, sans discontinuer, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de tristesse à cette froide journée de février. Le véhicule est déjà plein à craquer, mais après la troisième halte une place se libère, que je m’empresse de m’approprier. Je voyage jusqu’au terminus cette fois, pas question de passer tout le trajet debout, à la merci du moindre cahot, des coups de frein brusques du chauffeur, des mains baladeuses de vieux alcoolos.
La banlieue, dans tous les pays du monde, c’est chacun pour soi.
Le bus dégage cette odeur indéfinissable, mélange de peaux rarement lavées, de fringues de mauvaise qualité supportant mal l’humidité, la puanteur de trop de personnes entassées dans un espace restreint.
De la femme à côté de moi émane une fragrance d’épices ; une promesse de lendemains ensoleillés, de déjeuners languissants, les paupières lourdes d’une envie de sieste. Elle évoque la poussière des chemins, l’été, quand une saine transpiration trace des rigoles sur les visages hilares des gosses. Mais il suffit de regarder son visage à elle, encadré par le sombre tissu de son voile, pour déchanter aussitôt. Fermé, fatigué, empreint de cette lassitude que j’ai observée autour de moi toute ma vie. Elle serre son sac à main usé contre sa poitrine, des plastiques remplis de nourriture entre ses jambes. J’imagine ses journées, le marché deux matins par semaine, la supérette les autres jours. Des années à traîner la pitance quotidienne de sa famille dans les bus.
La pluie s’est intensifiée, l’odeur de chien mouillé des nouveaux arrivants a vite fait de dissiper les derniers effluves épicés. Je me détourne.
À intervalles réguliers, j’essuie la buée de la paume, pour regarder dehors. Le verre est glacial et humide. Je frotte ma main sur mon pantalon, autant pour la sécher que pour la réchauffer. Je me demande bien pourquoi je me donne systématiquement la peine d’essayer de distinguer l’extérieur. Des jours comme aujourd’hui, la pluie qui se dépose sur les vitres coupe toute visibilité. Et ceux où seul le froid règne, qu’ai-je à contempler de si intéressant, une fois la buée disparue ? Les mornes immeubles sans âme d’une banlieue après une autre ; du gris, du noir, du béton.
Chaque matin et chaque soir, j’accomplis ce trajet, accompagnée de milliers d’anonymes comme moi, qui exécutent cette transhumance silencieuse pour gagner de quoi survivre chichement dans leurs cités. Encore ai-je la chance de pouvoir ne circuler qu’en bus, de ne pas devoir m’engouffrer dans les fonds inquiétants du métro et du RER. Là où règnent l’angoisse moite des agressions et l’attente résignée des rames bondées.
Les bons jours, en levant bien haut la tête, j’aperçois le ciel et je peux prétendre que le béton s’est volatilisé.
***
Quand j’étais môme, je m’allongeais sur mon lit le dimanche après-midi, le visage tourné vers la fenêtre. J’avais découvert par hasard qu’en me tenant d’une certaine façon, j’arrivais à voir le ciel et seulement le ciel. Un rectangle magique et secret, où les tours environnantes disparaissaient. Si je bougeais ne serait-ce que de quelques centimètres, c’était foutu. Je pouvais rester très longtemps à regarder, compter les nuages, leur chercher des formes, des histoires, calculer leur vitesse. Comme je n’atteignais la position idéale qu’en me tordant en tous sens, j’étais endolorie quand je me relevais, et il me fallait quelques minutes pour que mes membres ankylosés retrouvent leur élasticité.
Les jours de grisaille, j’observais le papier peint, le plafond, les scrutant jusqu’à y discerner des têtes, des personnages, toute une armée de compagnons bienveillants qui veillaient sur mon enfance silencieuse et solitaire. Je croyais même parfois qu’ils me chuchotaient des mots sans importance, des paroles inintelligibles dont seule la mélodie comptait.
Je n’avais de toute façon pas grand-chose d’autre pour m’occuper. Mes jours sans école, je les passais à lire ou à confectionner des ouvrages au crochet, les uniques activités pour lesquelles maman me fournissait de la matière première. Je réalisais des napperons, des chemins de table, des cache-pots, des couvre-lits… Dès que j’en finissais un, je le lui laissais en offrande sur le canapé. Je le retrouvais invariablement dans la poubelle, sous le marc de café ou les épluchures de pommes de terre.
Ma mère ne me parlait pas, ou en tout cas peu, le moins possible. Plus je grandissais, moins elle communiquait. Quand la plupart des enfants rêvent d’autonomie, de conquérir des privilèges, moi, je rêvais d’activités avec elle.
À l’extérieur de l’appartement, en contact avec d’autres personnes, je découvrais une mère que je ne connaissais pas, une femme vive et rieuse, qui offrait un sourire à chacun, qui flirtait même parfois avec le boucher ou le l’épicier. Je contemplais les quelques rides au coin de ses yeux, des sillons de joie. Le simple fait d’aller acheter une baguette à la boulangerie avec elle m’emplissait de ravissement pour la semaine. Je rangeais soigneusement dans ma tête le moindre de ses accents, la plus petite inflexion de sa voix, les conservant amoureusement pour plus tard, quand, seule dans ma chambre, je regardais les ombres s’épaissir et la nuit envahir peu à peu la pièce. Le souvenir de ses rires, de ses plaisanteries, tenait mes terreurs d’enfant éloignées.
Malheureusement, d’abord rare, ce genre d’escapade s’interrompit définitivement après mes douze ans.
Mes camarades de classe participaient tous à des activités le mercredi : foot, judo, danse… Ils en parlaient à la cantine ou à la récré et je les enviais. Une fois, j’avais timidement demandé à maman si je pouvais moi aussi m’inscrire à la danse. Son regard dédaigneux avait été suffisamment éloquent pour me dissuader d’insister. L’idiotie de ma requête m’avait frappée après coup : jamais elle ne se donnerait la peine de m’accompagner et de venir me rechercher ! Autant croire au père Noël ou aux extra-terrestres. Plus tard, quand j’eus atteint l’âge de m’y rendre toute seule sans éveiller les soupçons du voisinage, ça ne m’attirait plus. Ma personnalité craintive et solitaire prenait le dessus.
Il paraît que mon géniteur est parti tellement vite après avoir séduit ma mère que son sperme n’avait pas encore séché sur les draps de l’hôtel miteux où il l’avait entraînée. Sans adresse, sans numéro de téléphone, sans même une identité, elle ne disposait, soutient-elle, d’aucun moyen de le joindre pour lui annoncer sa grossesse.
Alors, elle a continué sa morne vie, chargée d’un fardeau supplémentaire. Fille-mère dans un environnement social comme le nôtre, avec le jugement des autres, le rejet de sa famille, ça n’a pas dû être simple, je crois. À l’époque, elle était employée de mairie, et suivait des cours du soir pour passer une licence de lettres et devenir prof, le rêve de toute son existence. Bien évidemment, avec son maigre salaire, impossible de continuer. Le coût astronomique d’une baby-sitter l’a forcée à enterrer ses aspirations sous une épaisse couche de rancœur. Elle a tout laissé tomber, tout sacrifié pour moi.
À cause de moi.
Alors, forcément, j’ai vite compris que j’étais tenue à la perfection. Sauf que la notion de perfection pour ma mère se résumait surtout à « sois sage, ne fais pas de bruit, ne me dérange pas, pour que je puisse prétendre que tu n’existes pas, comme si tout ça n’avait jamais eu lieu ». Je n’étais pas contrariante, je me suis comportée comme elle le désirait.
Je suis sans doute une des rares personnes à avoir un carnet de santé presque vierge : pas de maladies, pas d’accidents, aucune hospitalisation. Les seules inscriptions consistent en des dates de vaccins et de visites médicales scolaires. J’ai été l’enfant idéale qu’elle exigeait : la perfection silencieuse et invisible, ne l’importunant jamais. Je me suis appliquée à devenir aussi insignifiante qu’un grain de poussière sous un meuble.
Elle sombrait petit à petit dans un alcoolisme discret, se saoulant le soir après mon coucher, et s’endormant une fois la vodka finie. Je me levais le lendemain matin et je feignais de ne pas voir la bouteille vide tombée près du canapé.
Tout ce que je sais de notre histoire, je l’ai glané çà et là, au fil de ses ivresses. Quelques phrases qui lui échappaient, des bribes éparses que j’ai patiemment accrochées les unes aux autres jusqu’à former un tout à peu près cohérent, une pelote de mots enroulée dans ma tête. Je suis consciente qu’il me manque encore beaucoup d’éléments, et le peu de mémoire que j’ai de ma petite enfance ne m’aide pas à y voir plus clair.
J’ignore par exemple si c’est elle qui m’a appris à parler — et pour ça, il fallait bien qu’elle m’adresse la parole —, ou si j’ai développé mon langage en entrant à la maternelle. Est-ce que je suis arrivée à trois ans, enfant sauvage mutique ? Ou gentille fillette babillant à tout va ? Et si elle communiquait pendant mes premières années, pourquoi a-t-elle cessé ? De quoi me parlait-elle ? D’aussi loin que je me souvienne, mes maîtresses d’école vantaient la richesse de mon vocabulaire et mon expression parfaite. Au CE1, l’instit m’avait prise pour exemple, rougissante, devant toute la classe, car j’étais la seule à mettre le « ne » dans mes phrases négatives à l’oral. Même si je lisais déjà tout ce qui me tombait sous la main, cela suffisait-il à expliquer ce langage précis et élaboré ?
Je maudis ce grand vide de mon enfance, ma mémoire défaillante, les ténèbres qui recouvrent ces premières années. Je me souviens de mon premier livre, une histoire de lapins perdus dans la forêt ; mais pas de maman à cette époque.
Elle travaillait tard, me laissant rentrer seule de l’école dès six ans, avec ma clé accrochée à une ficelle, pendant autour de mon cou. Je traversais la cité jusqu’à notre immeuble, rasant les murs, les yeux fixés sur le trottoir pour ne jamais établir de contact visuel avec les bandes qui traînaient et ne se gênaient pas pour apostropher les passants. Je m’acquittais de mes devoirs en regardant les ombres changer sur la moquette.
J’attendais maman, juste pour le bonheur de la voir, juste pour cette infime fraction de seconde où elle franchissait la porte, où elle enregistrait ma présence et pensait « la voilà, il ne lui est rien arrivé ». Une étincelle qui s’allumait dans son regard avant de s’éteindre à nouveau. Elle mettait la radio en route et j’obéissais à la règle implicite : quitter le salon et jouer dans ma chambre, jusqu’au dîner.
Certains soirs, elle rentrait vraiment très tard et mon estomac criait famine, mais jamais je n’aurais osé manger sans sa permission. Plus le temps passait, plus je m’angoissais. Et si elle ne revenait pas ? Si elle m’abandonnait définitivement ? J’étais tellement enfermée dans notre vie bizarre que si elle avait foutu le camp en me laissant derrière, je n’aurais même pas eu le réflexe d’alerter quelqu’un. Je serais morte de faim dans cet appartement inhospitalier et triste.
Je guettais derrière la porte de ma chambre l’écho de son corps qui s’affaissait sur le canapé, signe que le repas pouvait commencer. Je dînais toujours seule dans la cuisine, attentive aux bruits émanant du salon. Je m’arrangeais chaque soir pour avoir terminé avant elle, afin de ne pas lui imposer ma présence lorsqu’elle viendrait débarrasser son couvert et laver la vaisselle. Si je n’avais pas eu le temps de finir, aux prises avec un morceau de viande récalcitrant que mes dents d’enfant n’arrivaient pas à mâcher assez vite, tant pis, j’écourtais mon dîner, et filais dans ma chambre, le ventre encore creux. Puis le bruit de la bouteille qui cogne le verre m’indiquait qu’il était l’heure de me coucher.
Le mutisme qu’elle nous infligeait nous obligeait à trouver d’autres stratégies de communication. Elle signait les mots sur mon carnet de correspondance, que je laissais dans un coin de la table de la cuisine. Elle rédigeait les chèques pour la cantine et les glissait sous ma porte pour que je les remette à la directrice le lendemain. Elle remplissait avec excellence son rôle matériel de mère. Je crois que personne ne se doutait de la froideur et du silence qui régnaient à la maison. Et jamais il ne me serait venu à l’idée de m’en plaindre. J’étais tellement persuadée que la vie c’était ça, que mes camarades de classe vivaient de la même façon. Pendant longtemps, je n’ai disposé d’aucun point de comparaison.
Je me suis toujours débrouillée pour ne pas la déranger, rester invisible. Mon physique d’adolescente reflétait mon enfance, il en était la conséquence logique. Je ne me trouvais ni belle ni laide, de taille moyenne, mon visage me semblait quelconque, avec des cheveux roux comme unique signe distinctif. Tous les matins, je les nouais en chignon sévère ou en nattes serrées, pour tenter d’endiguer leur enthousiasme, leur envie de flotter au vent. Jusqu’à l’âge adulte, j’ai cru que les gens m’oubliaient aussitôt après m’avoir vue.
***
Aujourd’hui.
Le bus est arrêté depuis plusieurs minutes sur un pont. Dessous, les eaux grises et sales de la Seine coulent, indifférentes aux problèmes des hommes. Des klaxons rageurs fusent un peu partout, les encombrements de fin de journée battent leur plein, et l’énervement des uns et des autres fait monter inexorablement la tension dans l’habitacle. Je sens aux regards agacés des passagers vers l’extérieur que ce contretemps — pourtant prévisible — contrarie leurs plans. Une femme se plaint à sa voisine qu’elle va rater sa correspondance. Un homme tambourine du bout des doigts sur la barre à laquelle il se tient, ce bruit entêtant semble prodigieusement crisper le vieux à côté de lui. Mais bien sûr, il ne dira rien, l’autre pourrait l’interpréter de travers et sortir une arme quelconque. Dans nos quartiers, la vie ne vaut rien, et peut s’éteindre pour une broutille, un mot maladroit, un regard trop appuyé. Le vieux prend son mal en patience. Des portables vibrent avec hargne, bipent et sonnent un peu partout, des voix irritées aboient en réponse, engueulent copieusement leurs interlocuteurs.
— Où je suis ? Dans ce putain de bus, qu’est-ce que tu crois ? Toujours ces bouchons de merde !
Chaque grossièreté me fait grimacer, je n’ai jamais réussi à m’y habituer, à comprendre pourquoi des gens qui ont la chance d’être entourés de personnes qui leur parlent se sentent obligés d’émailler leurs discours de vulgarité et d’insultes.
La pluie s’est un peu calmée, mais les passants continuent à marcher vite, comme si leur destination pouvait présenter un intérêt quelconque. Une femme court jusqu’au bus immobilisé, portant une fillette, elle frappe à la porte avant. Le chauffeur hésite un instant, mais finit par ouvrir. La femme, la trentaine, le remercie d’un sourire chaleureux et s’avance dans la traverse après avoir présenté son titre de transport, l’enfant toujours dans les bras. La gamine est vêtue d’un manteau multicolore qui égaye soudain tout le véhicule. Elle doit avoir trois ou quatre ans et parle d’une petite voix aiguë attendrissante. Elle montre du doigt à sa mère les péniches qui ondulent nonchalamment sur les berges. Elle ne semble pas être dérangée par les gouttes de pluie qui coulent encore sur elle, par la promiscuité et les visages éteints des gens autour d’elle. Tout son être est concentré sur les péniches, elle annonce qu’elle vivra sur un bateau quand elle sera grande, qu’elle y invitera ses parents.
La complicité entre les deux, leur confiance mutuelle est presque perturbante. Je détourne le regard, aussi gênée que si je m’étais immiscée dans leur intimité.
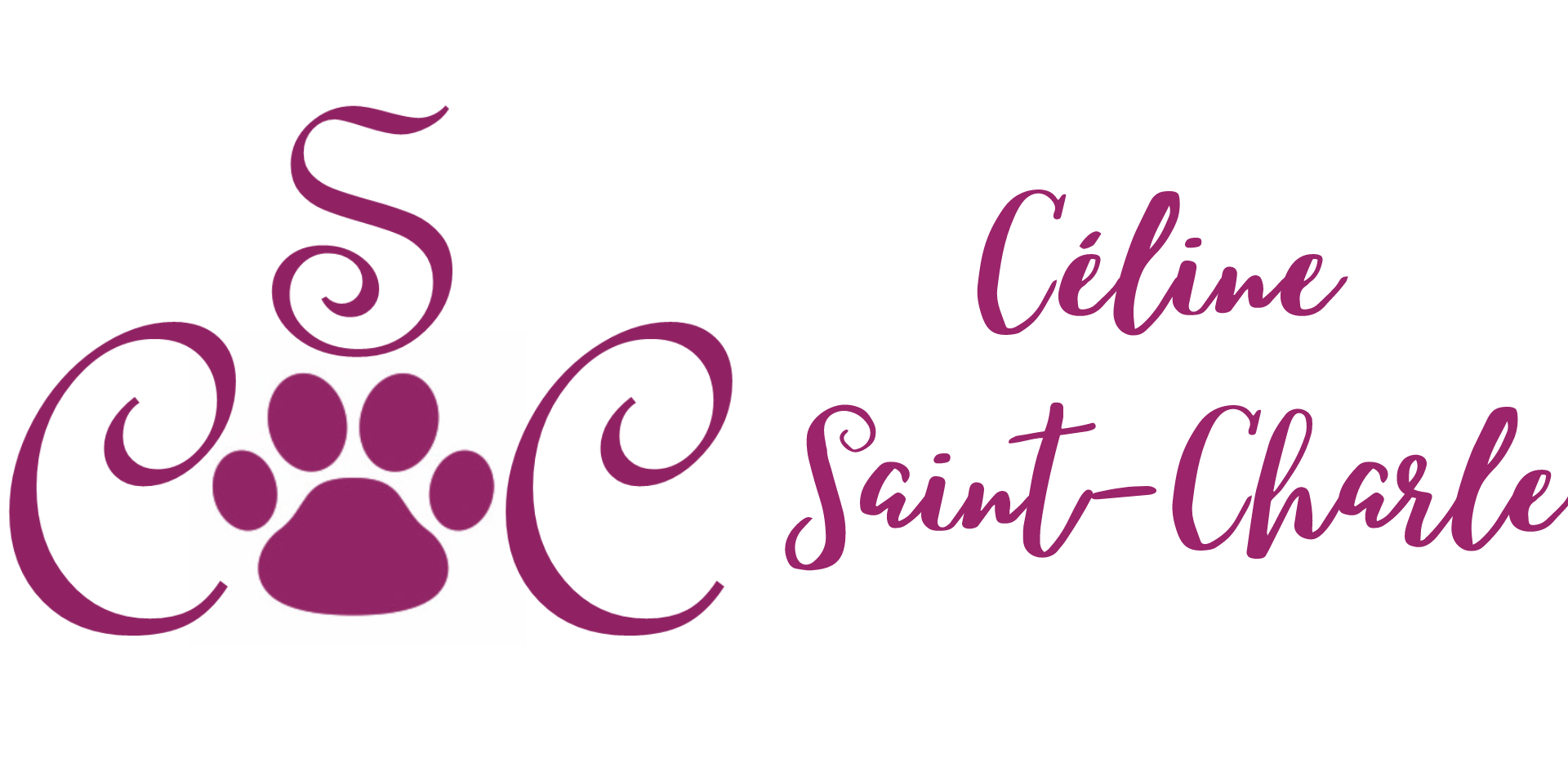

J’apprécie l’écriture. Je dois
consacrer d’avantage de
Temps à ce roman
J’aimeAimé par 1 personne
Comme d’habitude, on lit la première ligne et on ne peut s’arrêter avant la fin…il me tarde de lire la suite… de savoir ce qui lui arrive…. tellement on est déjà pris dans l’histoire…
J’aimeAimé par 1 personne